Quand les riverains d’un projet s’aperçoivent que leur environnement va être détruit pour le bénéfice de quelques uns au détriment de l’intérêt général, la voie légale pour faire part de leur opposition est l’enquête publique. Pourtant, les avis rendus par les enquêtrices et enquêteurs sur les projets sont très, très rarement négatifs, même quand les citoyennes et les citoyens se sont mobilisé.es en grand nombre pour y participer…
Et voilà. C’est plié. L’autoroute, le barrage, les dizaines d’hectares de panneaux photovoltaïques sont déclarés « d’utilité publique ». Il va falloir l’accepter. En fait non. De plus en plus souvent, dès l’avis rendu, les opposants se préparent à une coûteuse procédure juridique, tellement longue que s’ils n’en viennent pas à une contestation physique, l’eau sera accaparée par quelques uns, l’environnement pollué, la forêt rasée, les terres agricoles artificialisées et/ou les espèces protégées détruites autant que le paysage. Il faut du courage pour se lancer dans la bataille et même si la mobilisation finit souvent par payer, est-il bien normal qu’on doive en arriver là ? Que des citoyennes et des citoyens consacrent une partie de leur vie et de leurs revenus à obtenir que l’intérêt général prévale enfin ?
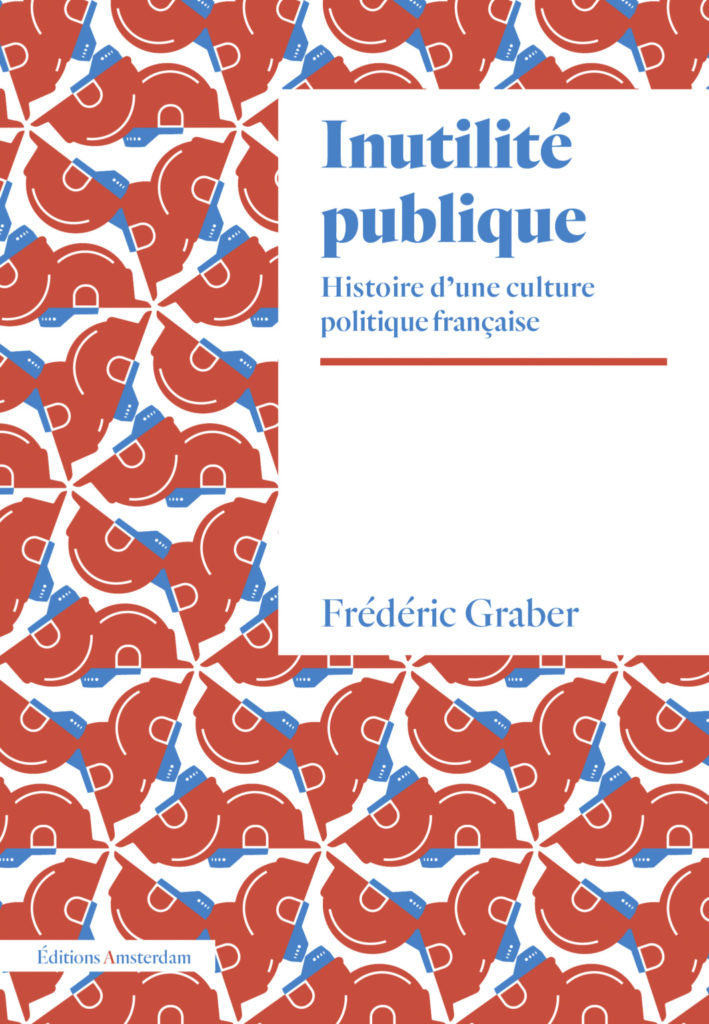
La notion d’utilité publique est au cœur de la légitimation des projets industriels et des infrastructures par les pouvoirs publics français. Aux yeux de l’administration, l’utilité publique ne renvoie pas à l’idée générale de bien commun, c’est un principe au nom duquel il est juridiquement possible de transformer l’état du monde – y compris si certaines populations doivent en subir les conséquences. Et la conformité ou non d’un projet à ce principe résulte d’une procédure administrative méconnue : l’enquête publique, mise en scène par excellence du consentement.
Frédéric Graber propose dans ce livre un décryptage minutieux de ce rouage central de l’économie des projets. Retraçant l’histoire de la fiction juridique qu’est l’utilité publique, il montre comment la référence à ce principe, formulé sous l’Ancien régime pour favoriser certains intérêts tout en se prévalant d’une forme de justice, a été maintenue jusqu’à nos jours. Il en résulte un éclairage saisissant sur l’aversion au débat caractéristique de la culture politique française.
Frédéric Graber est historien au CNRS. Ses travaux portent sur l’histoire environnementale des mondes contemporains, la gestion de l’eau, l’administration des populations et les formes d’action collective, les projets en particulier. Il est également l’auteur de Posséder la nature, Environnement et propriété dans l’histoire, paru en mai 2022 aux éditions Asterdam.
Inutilité publique, de Frédéric Graber, aux éditions Amsterdam, octobre 2022, 208 p., 18 euros.
Couverture © Sylvain Lamy







